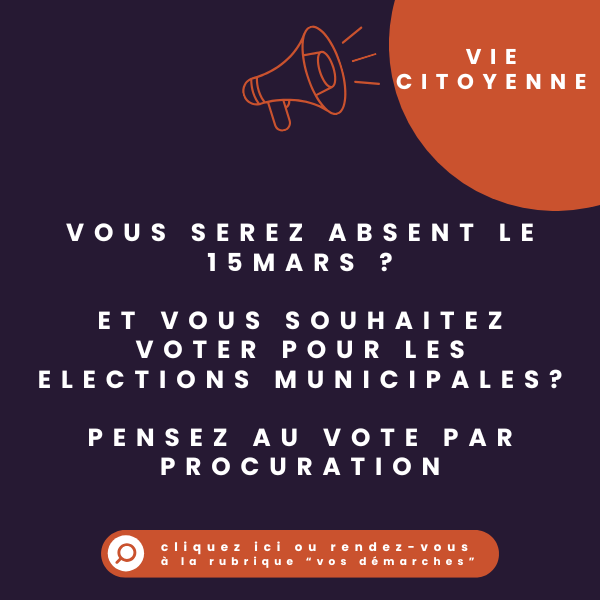Quand je rentre, elle est là devant la ferme. Elle a mis ses bottes. Elle est belle comme ça, sans son tablier blanc.
6h50, le soleil pointe le bout de son nez. Ce changement d’heure me tuera. De l’autre côté, la lune est un gros point blanc dans le ciel. Les oiseaux sont lancés dans leur concert. Ça sent bon la terre à la fraîche. La vue est toujours aussi belle. Les feuilles poussent sur les arbres et les coteaux ont l’air doux avec juste ce petit filet de brume au fond. Quand je ne travaillerai plus, je ferai de la photo ou peut-être j’aimerai apprendre à peindre tout ça, le rose le mauve… Allez assez rêvassé ! Le temps est resté au beau, ce n’est pas le boulot qui manque.
J’aperçois au loin, sur l’autre versant, les phares de sa voiture qui file vers son travail. C’est devenu un peu tendu. C’est comme si on vivait dans deux mondes différents. Je la sens très angoissée, épuisée. Ses cernes bleus ne quittent plus ses yeux. Elle dort par épisodes d’un mauvais sommeil. Je la sens nerveuse mais elle ne parle pas. Ce n’est pas bon ça. Je le sais. Je la connais. Elle dit qu’il vaut mieux que je ne sache pas tout, tout ce qu’elle voit. Ce n’est plus un orage qui se prépare… Ça la ronge du dedans.
Tout en travaillant, j’écoute les infos. Rien de bon, je me demande comment ça va finir tout ça. Comment le pays va tenir, l’économie ? Le monde est devenu fou, on marche sur la tête. Et moi là-dedans, comment je vais survivre ? Il est grand temps que l’on se rende compte qu’on a fait n’importe quoi là-haut, les décideurs, mais aussi nous, chacun dans notre coin. La tête dans le guidon, on avance et puis c’est quand on est dans le mur et qu’on se la prend la claque… Et là, je vais te dire Marguerite, si on ne prend pas les choses en main, hein…Tu t’en fous toi, hein ! Tu as de quoi manger, ton petit te tête et tout va bien. Je vais te dire, tu as raison tiens ! Je me bile mais j’ai un toit, j’ai à manger, à boire, de quoi me chauffer en hiver, je ne suis pas riche mais et alors ? J’ai de beaux enfants. Ils travaillent tous, je suis en bonne santé jusque-là… mais tu vois, je suis inquiet pour elle. Tu le sens aussi toi quand elle vient te voir le soir quand elle rentre ? Pff ! Quelle vie ! Allez je te laisse, on va ruminer chacun dans son coin.
Sur le chemin du champ, pas une âme qui vive… pas la moindre voiture à pester derrière le tracteur, ça me manque, tiens ! Ah si, je croise le facteur. On se fait signe. Lui aussi, il continue de travailler. Ça doit faire plaisir aux gens de le voir encore. Le soleil tape et la journée se passe, affairée, à prévoir demain.
Quand je rentre, elle est là devant la ferme. Elle a mis ses bottes. Elle est belle comme ça, sans son tablier blanc. Je me gare et je viens vers elle. Elle se jette dans mes bras et me serre fort. Quand j’essaie de l’écarter pour l’embrasser, elle se cache dans mon cou et elle pleure. Ça y est ! Il pleut ! Je n’aime pas ça mais je sais que ça va lui faire du bien. Alors, on reste planté là, longtemps, sans un mot, le temps que l’averse passe. Je lui frotte le dos, caresse les cheveux. Puis elle s’écarte, prend ma main :
« Viens, on va aux bêtes »
C’est là, appuyés aux barrières à regarder Marguerite et son petit qu’elle parle enfin. Elle parle sans plus s’arrêter des malades, du matériel qui manque, des protections qui sont défaillantes, de l’égoïsme des gens, de la peur pour elle, pour nous, de son patient de 25 ans qui vient de mourir. C’est l’âge de notre fille. Elle sait qu’ils ne seront plus tous là, au bout, qu’ils vont tomber comme des mouches à force de soigner. Elle parle des réflexions horribles qu’elle a entendues sur l’organisation du planning à propos de celles qu’on mettra davantage au combat parce qu’elles n’ont pas d’enfants, qu’elles sont jeunes ou qu’elles sont proches de la retraite. Les patients qu’on ne mettra pas en soins intensifs par manque de lits, ceux qu’on condamnera en fait. Sa colère et son impuissance, elle est à bout. Elle me caresse la joue :
« Ça va, toi ?
— Oui ».
Je ne peux que répondre : « Oui, ça va aller ».
Régine Michaux